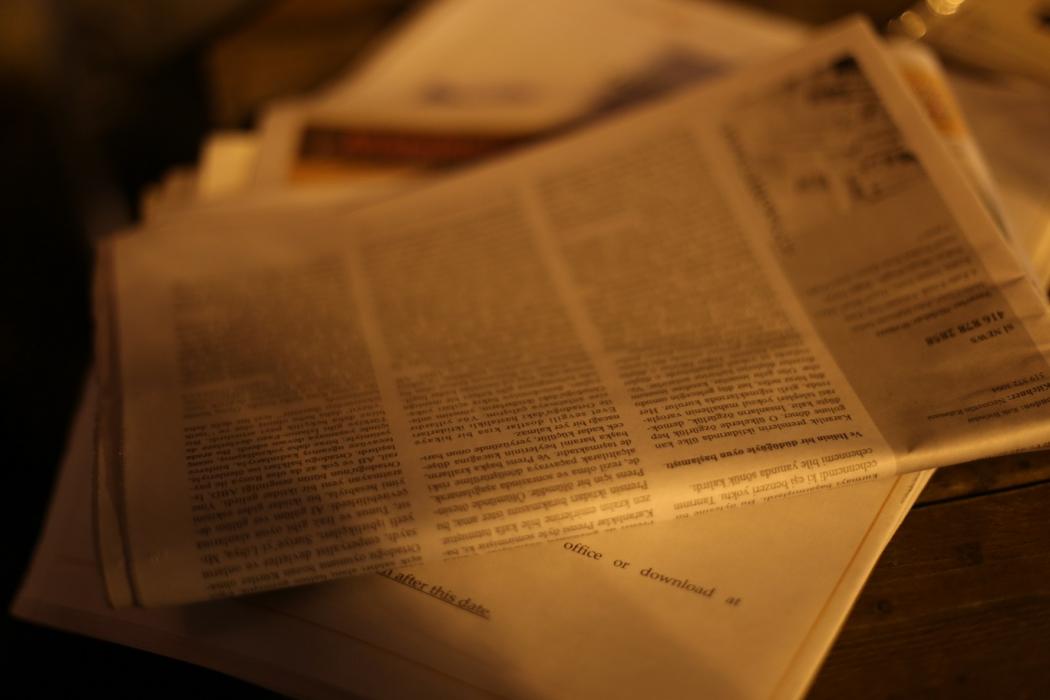
L'auteure est présidente de la Fédération nationale des communications de la CSN.
Je suis inquiète pour l’avenir de l’information. Je suis inquiète pour la démocratie. Je suis inquiète pour les progrès qui ont marqué le dernier siècle en termes d’ouverture aux différences et d’avancées pour les droits de la personne. Les médias, les artistes et le milieu culturel ont indéniablement participé à faire connaître à la majorité des réalités méconnues et des situations d’injustices vécues par tant de personnes et de groupes opprimés et vulnérables. L’émergence, la solidité, l’abondance et la notoriété d’une presse libre et indépendante dans les pays occidentaux pendant cette période a incontestablement participé aux débats qui ont mené à l’émancipation des femmes, pour ne nommer que cet exemple probant, et à l’inclusion dans nos chartes québécoise et canadienne d’articles qui rejettent la discrimination en fonction de l’orientation sexuelle, du genre, de la race, de la religion, etc.
Cet article a été publié dans le recueil (in)visibilités médiatiques de L'Esprit libre. Il est disponible sur notre boutique en ligne ou dans plusieurs librairies indépendantes.
Je suis inquiète parce que les bases économiques qui soutiennent les médias qui nous ont tant renseignés-es, éclairés-es et informés-es sur le monde sont fragilisées au point où le tiers des emplois dans la presse écrite a disparu en cinq ans (de 2010 à 2015), que la télévision traditionnelle et généraliste a amorcé un déclin qui entraîne de nombreuses restructurations et pertes d’emplois, et que la plupart des radios ont depuis longtemps délaissé ou rationalisé leurs vaillantes salles de nouvelles afin de diminuer leurs coûts de production.
Un événement inédit au Québec s’est produit au printemps dernier. La Fédération nationale des communications (FNC-CSN) a organisé en partenariat avec la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ), le Conseil de presse du Québec (CPQ) et le Centre d’études sur les médias de l’Université Laval (CEM), un colloque qui a réuni dans une même salle des patrons-nes de presse, des journalistes, des syndicalistes, des chercheurs et chercheuses en journalisme et en communication, des étudiants-es et même des représentants-es du gouvernement afin de faire le point sur la situation et de discuter de pistes de solutions. Au terme de ce colloque, dans les semaines et les mois qui ont suivi, plusieurs voix, incluant celles de dirigeants-es de syndicats et d’entreprises réputées, ont réclamé des gouvernements provincial et fédéral des allégements fiscaux afin de permettre aux entreprises de la presse écrite de se sortir la tête de l’eau. Jamais de telles démarches n’ont été faites par le passé, car la presse écrite a toujours été jalouse de son indépendance face aux pouvoirs publics. Entendez-vous le signal d’alarme?
Je suis inquiète, car l’information a perdu une grande part de sa valeur commerciale et que, jusqu’à aujourd’hui, ni les gouvernements, ni les annonceurs, ni le public ne semblent massivement disposés à préserver leurs organes de presse. En fait, je ne crois pas que nous soyons tous et toutes pleinement conscients-es de la valeur du service public que ces derniers garantissent en surveillant les pouvoirs officiels (exécutif, législatif et judiciaire). Par conséquent, je m’inquiète pour l’avenir de l’information, pour la démocratie et pour les avancées sociales et humaines, car dans l’obscurité et le silence, l’imputabilité n’existe pas.
À la défense de nos médias d’information
Nos médias ne sont pas parfaits et ne l’ont jamais été. Sont-ils équitables dans leur façon de couvrir des sujets qui touchent certaines minorités? Engagent-ils suffisamment de personnel représentatif de la diversité de nos communautés? Accordent-ils la parole autant aux plus démunis-es et vulnérables de nos sociétés qu’aux élites? Sont-ils toujours justes dans leur façon de traiter des sujets explosifs ou accordent-ils plus d’importance aux points de vue qui semblent partagés par la majorité de leur public et qui plaisent aux annonceurs? À mon avis, il est sain de se poser ces questions et de tenter d’y répondre (ce que je ne me risquerai pas à faire dans le cadre de cet article). Cependant, quelques notions sont à considérer avant toute chose.
Tout d’abord, on ne peut imposer à un seul média, aussi grand et réputé soit-il, le fardeau de représenter toutes les réalités, tous les points de vue et toutes les opinions imaginables. Le plus grand danger qui guette une presse libre et indépendante est le monopole et la concentration entre trop peu de mains de nos organes d’information. La pluralité des sources d’information et la diversité des voix sont essentielles pour que les médias se complètent, se défient, se regardent, se critiquent. Avec l’addition des sources, le public peut se faire une idée globale du monde qui l’entoure plutôt que de ne connaître que la vision d’un seul média ou d’un-e unique journaliste qui présente des sujets choisis et abordés selon ses valeurs, ses idées, ses critères. Une lanterne isolée n’éclaire qu’une petite partie à la fois d’une vaste chambre. Un ensemble de lanternes peut illuminer la pièce tout entière et permettre d’y découvrir tout ce qui s’y trouve.
Ensuite, la capacité d’un média de couvrir en profondeur l’actualité, de chercher la vérité même lorsqu’elle est habilement camouflée par de puissants intérêts ou qu’elle requiert des semaines d’enquêtes pour être découverte, de s’intéresser à la fois à ce qui est près et loin de nous, d’amener à notre attention des réalités qui nous sont totalement étrangères, dépend autant de sa solidité financière que de la volonté des propriétaires et de ses artisans-es. Produire de l’information de qualité coûte cher.
L’industrie de l’information, depuis sa naissance, a évolué vers une presse professionnelle, avec de rigoureux critères journalistiques, des codes de déontologie contraignants, des formations spécifiques à la profession. Le Québec s’est même doté d’un tribunal d’honneur, le Conseil de presse du Québec, qui reçoit les plaintes du public sur la couverture journalistique, et d’organismes de réglementation tels que le CRTC. Comme société, nous nous sommes donné des médias publics, privés, communautaires, scientifiques, spécialisés, de niches, etc. En somme, malgré l’opinion qu’on peut avoir d’un média ou d’un autre, nous avons un univers médiatique de grande valeur, crédible et varié qu’il nous est permis de critiquer et dont nous pouvons exiger ce qu’il y a de mieux.
Cet univers médiatique est devenu possible entre autres parce que l’information avait une valeur commerciale. Concrètement, les médias produisent de l’information et l'offrent à un public. Les médias vendent ensuite aux annonceurs du temps d'attention de leurs lecteurs-trices aux entreprises. Ces annonceurs paient d'ailleurs beaucoup d’argent pour annoncer leurs produits et services à ce public, dont l'esprit est disponible grâce à l'intérêt suscité par la nouvelle. En puisant leurs revenus de deux principales sources, soit les abonnements et la publicité, tant que cela a été rentable, les médias ont pu se constituer des salles de nouvelles remplies de journalistes, de professionnels-les de l’information et de nombreux autres types d’employés-es qui, grâce à leurs conditions de travail décentes, ont pu consacrer leur carrière professionnelle à creuser et à raconter des histoires d’intérêt public.
À cette étape-ci, il m’est nécessaire de rappeler que le métier de journaliste n’a pas toujours été glorieux. Au tout début, la paie était tellement maigre que nombre de « nouvellistes » (on les appelait comme cela à l’époque) arrondissaient leur fin de mois en acceptant des enveloppes brunes d’entreprises, de politiciens ou autres, pour rédiger des papiers favorables. Ou encore, elles et ils occupaient d’autres emplois qui pouvaient miner leur indépendance et n’accordaient pas autant de temps et d’énergie à fouiller des histoires. Pour les femmes, dès qu’elles se mariaient, elles devaient quitter leur travail qui, de toute façon, les avait confinées à la presse dite « féminine ». Par exemple, on pouvait leur demander de rédiger un texte sur le nouveau modèle de malaxeur! De plus, les journalistes étaient soumis-es à l’arbitraire du patron qui, parfois, brandissait des menaces de congédiement pour orienter les articles et les sujets selon ses propres intérêts.
Exaspérés-es de vivre dans la précarité et de voir leur autonomie professionnelle constamment sous pression, les journalistes se sont organisés-es en syndicats. Au fil d’épiques luttes syndicales teintées à l’occasion de violences, de grèves et de lockouts, elles et ils ont peu à peu réussi à améliorer leurs conditions de travail et leurs clauses professionnelles afin de protéger leur indépendance et l’éthique journalistique. Ce fut le cas pour les journalistes syndiqués-es, à tout le moins, puisque la situation est tout à fait déplorable pour une large majorité de pigistes, contractuels-les et journalistes indépendants-es, dont les tarifs au feuillet ont cessé d’augmenter depuis plus de 30 ans, alors que le coût de la vie, lui, grimpe toujours. Cela est sans parler de leurs droits d’auteur-e et moraux qu’elles et ils sont de plus en plus contraints-es de céder aux employeurs et employeuses, les privant ainsi des recettes de leurs œuvres. Il est d’ailleurs grand temps que le gouvernement accède à la demande de l’Association des journalistes indépendants du Québec (AJIQ), soit de les doter d’une loi similaire à celle sur le Statut de l’artiste qui leur permettrait de négocier des conditions de pratiques minimales et décentes.
Aujourd’hui, ces gains qui ont permis aux médias d’exister et d’être viables sont de plus en plus menacés. Avec l’avènement d’Internet, des réseaux sociaux, des moteurs de recherche et autres plateformes de diffusion, le public s’est habitué à trouver de tout gratuitement. Il est donc de moins en moins enclin à payer pour être informé. Du côté des annonceurs, l’univers numérique a provoqué l’éclatement des possibilités publicitaires et ils peuvent aujourd’hui rejoindre leur clientèle sur d’autres plateformes efficaces et économiques.
En effet, les Facebook, Google, Twitter et autres géants mondiaux du Web, américains pour la plupart, ont développé des outils très précis pour aider les annonceurs à cibler et à rejoindre leur clientèle. Ces compagnies ne développent aucun contenu (ou presque pas et encore moins en matière d’information), ne connaissent aucune frontière physique géographique et possèdent une structure de coût d’exploitation minime par rapport au potentiel de revenus. Elles ont fait chuter dramatiquement le coût de la publicité en offrant des prix avec lesquels les médias traditionnels ne peuvent rivaliser, eux qui sont limités par la taille de leur marché et par leurs coûts de production très élevés. Donc non seulement ces applications reproduisent-elles gratuitement le contenu produit à grands frais par d’autres, mais en plus, elles empochent le pactole en termes de revenus publicitaires. Pour ajouter à la problématique de l’argent que ces compagnies engrangent chez nous, elles n’en redonnent à peu près pas à nos communautés, car elles emploient peu de gens chez nous, ne retournent pratiquement aucune taxe et ne paient aucun impôt.
Ceci étant dit, on n’arrêtera pas le progrès! Les médias doivent composer avec cette réalité contemporaine et ils doivent trouver des solutions. Rien n’indique cependant que la majorité d’entre eux sont à l’aube de trouver une nouvelle façon de rentabiliser leurs activités. Certains expérimentent de nouveaux modèles, mais aucune nouvelle source de revenus n’a été mise en place. Au contraire, certains médias dépendent aujourd’hui plus que jamais des revenus publicitaires ayant rendu leur contenu gratuit, et d’autres, ayant de moins en moins d’annonceurs, dépendent de plus en plus de la générosité de leur public prêt à payer pour être abonné ou à faire des dons de charité.
C’est ainsi que depuis au moins deux décennies, nous assistons à des rondes de restructurations, à des ventes, à des rachats, à des mises à pied, à des reculs dans les conditions de travail, à la précarisation des emplois, à la disparition de certains métiers et de certaines expertises. Certains médias en sont désormais à l’étape de fermeture. Dernièrement, nous avons vu disparaître au Québec des médias régionaux, plusieurs médias communautaires, spécialisés et de niches. Pensons au Canal Argent du Groupe TVA, la seule chaîne spécialisée en économie, ou encore à plusieurs journaux hebdomadaires qui ont fermé leurs portes à la suite du rachat par Transcontinental des propriétés de Québecor, etc. Jusqu’ici, nos gros piliers ont été épargnés, mais pour combien de temps encore si rien ne change? Et qu’en est-il de la diversité avec la disparition de voix alternatives?
On me dira que la nature a horreur du vide et que de l’hypothétique mort de nos médias traditionnels naîtra autre chose. Cette autre chose m’effraie. Les médias se sont structurés ainsi car ils doivent avoir les reins solides pour exposer les côtés les plus sombres de nos sociétés, et parfois les plus lumineux, et ainsi les faire évoluer. Parler librement demande une indépendance économique et une capacité à se défendre devant les tribunaux en cas de poursuite. (Pensons par exemple à la publication satirique Le Journal de Mourreal qui est impuissant pour se défendre face à l’empire Québecor.) Ce ne sont pas les GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) qui feront ce travail. Ce n’est pas leur mission. De toute manière, voudrait-on confier à des entreprises américaines le soin de nous informer chez nous?
Ce n’est pas non plus le public qui « s’auto-informera », car malgré les nombreuses occasions pour la population générale de s’exprimer et de se raconter sur le Web, il ne peut remplacer le travail d’un-e journaliste qui y consacre sa vie professionnelle. Qui a le temps, l’argent et l’énergie nécessaires pour débusquer et mettre à jour les grands scandales de notre époque? Bien que certains événements ponctuels peuvent être rapportés par les membres du public et que cela a certes une valeur informative, seuls des médias de masse avec d’importantes ressources économiques ont pu, par exemple, enquêter sur la corruption et la collusion dans le monde de la construction et ont forcé le gouvernement à mettre sur pied la Commission Charbonneau. D’autant plus que comme ces médias monopolisent en grande partie l’espace médiatique, ces informations cruciales pour la vie démocratique risquent de demeurer dans l’ombre si elles étaient révélées par de petits médias. En ce sens, le rôle des médias est sans doute appelé à changer et à aller toujours plus vers l’enquête et l’analyse plutôt que le scoop ou l’événementiel, mais encore une fois, cela coûte cher. Il est paradoxal de constater que la tendance actuelle est plutôt à l’inverse car les médias cherchent encore le scoop et le sensationnel pour obtenir le plus de clics possibles.
Je mentionnais plus tôt l’importance de la pluralité des voix. Si peu s’indignent des fermetures récentes de médias, je me dois de rappeler qu’à chaque fois que l’un d’entre eux s’éteint, ce sont des histoires qui ne seront jamais racontées. C’est une portion de la réalité qui ne sera jamais connue par d’autres que celles et ceux qui la vivent. C’est une prise de conscience collective d’une injustice, une réparation et un changement qui n’auront pas lieu. Bref, c’est un brin de démocratie qui s’envole.
Le salut par les réseaux sociaux et Internet?
Les plus récentes études démontrent que les citoyens-nes trouvent de plus en plus leurs informations en ligne, sur les réseaux sociaux et les moteurs de recherches. Les statistiques indiquent que les jeunes particulièrement ont adopté massivement ces habitudes de consommation. Analysons un peu plus ce que cela veut dire.
D’une part, l’information qui se retrouve sur ces réseaux est en majeure partie celle produite par nos médias traditionnels et c’est encore à cette information que le public fait le plus confiance. Même s’ils la découvrent sur d’autres plateformes, les gens se réfèrent encore aux marques qu’ils respectent. Par contre, les études démontrent également que sur ces réseaux, les gens distinguent difficilement l’information véritable des rumeurs, opinions, commentaires, parodies, publicités ou contenus commandités. Cela attise peut-être un certain cynisme ou scepticisme envers les médias.
D’autre part, l’information qui est présentée aux usagères et aux usagers de ces réseaux sociaux apparaît sur les fils d’actualité à la suite d’algorithmes programmés par ces géants du Web. En plus d’être la plupart du temps secrets ou sinon incompréhensibles pour le commun des mortels, ces algorithmes existent non pas pour servir l’intérêt public, mais d’abord et avant tout pour servir l’intérêt commercial de ces entreprises. Grâce aux données que ces applications accumulent sur leurs usagères et usagers, elles peuvent cerner de façon toujours plus précise leurs intérêts, leurs habitudes de consommation, de vie et d’information et les gaver toujours plus de ce qui les intéresse déjà.
En effet, les médias sociaux servent à conforter les gens et non pas à les exposer à des choses qu’ils ne connaissent pas ou qui les amèneraient à remettre leurs croyances en question. Le terme le dit : réseaux sociaux. Donc des endroits qu’on choisit pour socialiser, pour être entre amis-es. Ce ne sont pas des médias d’information avec des règles et une mission démocratique. Si les médias traditionnels ont réussi à exposer des masses à des réalités particulières, on peut douter que les réseaux sociaux remplissent cette fonction parce que leur objectif est avant tout d’être rentables financièrement; leur mission n’est pas reliée à informer les utilisatrices et utilisateurs.
En plus de poser de sérieux défis aux concepts de vie privée et de sécurité, on est en droit de se demander jusqu’à quel degré ces réseaux sociaux participent à la polarisation des idées. Alors que de plus en plus de gens disent s’informer uniquement par les réseaux sociaux dont les algorithmes ne favorisent pas la diversité des points de vue, on voit actuellement de grandes portions de la population s'ancrer dans leurs positions. Sans oublier que n’importe qui dit à peu près n’importe quoi sur ces plateformes. La liberté d’expression à son meilleur et à son pire.
Des pistes de solution?
D’immenses efforts doivent être mis du côté de l’éducation populaire et une importante mobilisation de l’industrie médiatique est à bâtir. Les médias d’information doivent mieux expliquer, défendre et promouvoir leur rôle. Les journalistes doivent constamment rappeler l’importance de leur travail et démontrer en quoi il est à la base de nos sociétés modernes. Nous ne pouvons présumer que tous et toutes sont familières et familiers avec ces concepts et nous avons trop à perdre du déclin de nos médias. À la modestie doit substituer la fierté de participer à rendre nos sociétés plus aptes à faire des choix collectifs éclairés.
De surcroît, la population doit mieux connaître le fonctionnement des réseaux sociaux et le rôle des algorithmes. Elle doit être en mesure de distinguer le vrai du faux, de savoir que ce qu’elle voit sur ses fils d’actualité n’est qu’une petite partie du monde, qu’une facette d’elle-même et de son environnement immédiat. Le milieu scolaire a certainement un rôle à jouer là-dedans. L’école sert aussi à former des citoyens-nes capables de comprendre la société dans laquelle elles et ils évoluent, pas seulement des travailleuses et des travailleurs. Les médias d’information devraient faire partie des outils intégrés au cursus scolaire. Il devrait également y avoir une formation de base sur le rôle des médias et sur leur fonctionnement pour que les élèves puissent s’en servir pour élargir leur apprentissage, développer l’habitude de s’informer chez les professionnels-les de l’information, et former leur esprit critique par rapport à ce qui est rapporté.
Les médias ont aussi la responsabilité de trouver leur place dans l’univers numérique. Ils doivent se réinventer pour aller rejoindre leur public là où il se trouve, tout en préservant ce qui fait d’eux des références respectées. En quelque sorte, ils ont la difficile mission de trouver la recette entre la flexibilité technologique des nouvelles entreprises du Web tout en préservant les principes, l’éthique et la rigueur des médias traditionnels. Pas évident quand l’information n’a plus la valeur commerciale pour attirer les revenus qu’elle a eus par le passé.
En ce sens, je crois que les médias doivent apprendre à travailler ensemble, et vite, pour assurer leur avenir, car les développements technologiques nécessitent d’importants investissements qui ne sont pas à la portée de tous et de toutes. Si chacun de son côté continue d’engloutir des sommes colossales dans la conception de nouvelles applications et plateformes, que reste-t-il pour le contenu? Je pense que si les médias doivent mettre en commun quelques ressources pour s’entraider, c’est sur la technologie, la distribution numérique de leurs contenus. Qu’arrivera-t-il lors de la prochaine grande avancée technologique? Qui aura les moyens de faire un nouveau La Presse+ en réalité virtuelle par exemple?
Les gouvernements doivent aussi agir et sans tarder. Comme ils l’ont fait par le passé pour favoriser l’émergence d’une culture québécoise et canadienne, ils doivent mettre en place des mesures fiscales et réglementaires qui permettront à nos industries de survivre malgré la forte compétition mondiale. Ils ont entre les mains plusieurs pistes de solution qui leur ont été présentées par nombre de joueurs de l’industrie. La FNC-CSN a soumis plusieurs mémoires et études qui démontrent que des mesures fiscales transitoires qui garantissent la séparation entre l’État et les médias sont nécessaires. La plus importante consisterait en la mise en place d’un crédit d’impôt sur la masse salariale. Cela permettrait aux entreprises de maintenir leurs effectifs et peut-être même de les augmenter.
Nos gouvernements ont aussi le pouvoir de dompter les géants du Web qui ne participent en rien à l’économie de notre pays et qui ne contribuent aucunement au foisonnement de notre industrie. Il s’agit d’avantages fiscaux illégaux dont ne bénéficie pas notre industrie qui, elle, paie ses taxes, ses impôts et qui est fortement réglementée. Comment pouvons-nous espérer sauver nos entreprises dans ce contexte ?
Enfin, une grande part de la solution est entre les mains du public. L’information n’est pas gratuite. Si on ne paie plus au moyen des abonnements ou encore par l’achat de publicité dans nos médias locaux, alors, il faudra accepter de payer autrement, que ce soit par le biais de taxes ou de redevances. C’est le coût d’une société démocratique. Un pays sans médias, sans information produite par des sources indépendantes, est une dictature.
Comme je l’ai mentionné d’entrée de jeu, on doit se questionner sur la représentation et la place des groupes et des idées minoritaires dans les médias de masse, mais ce qui participe en quelque sorte à une plus grande variété dans nos médias est la pluralité des voix. Alors que notre industrie est grandement fragilisée, que les signaux d’alarme ont été lancés, que des solutions ont été proposées, je suis inquiète du manque d’empressement à les mettre en place. Je suis inquiète pour notre ouverture sur le monde. Je suis inquiète pour la place au débat, pour l’exposition aux idées contraires. Je suis inquiète pour nos droits acquis et pour les injustices qui restent à dénoncer. Je suis inquiète pour l’avenir de l’information. Je suis inquiète pour notre démocratie.
CRÉDIT PHOTO: Revue L'Esprit libre - Caroline Chéadé


Ajouter un commentaire