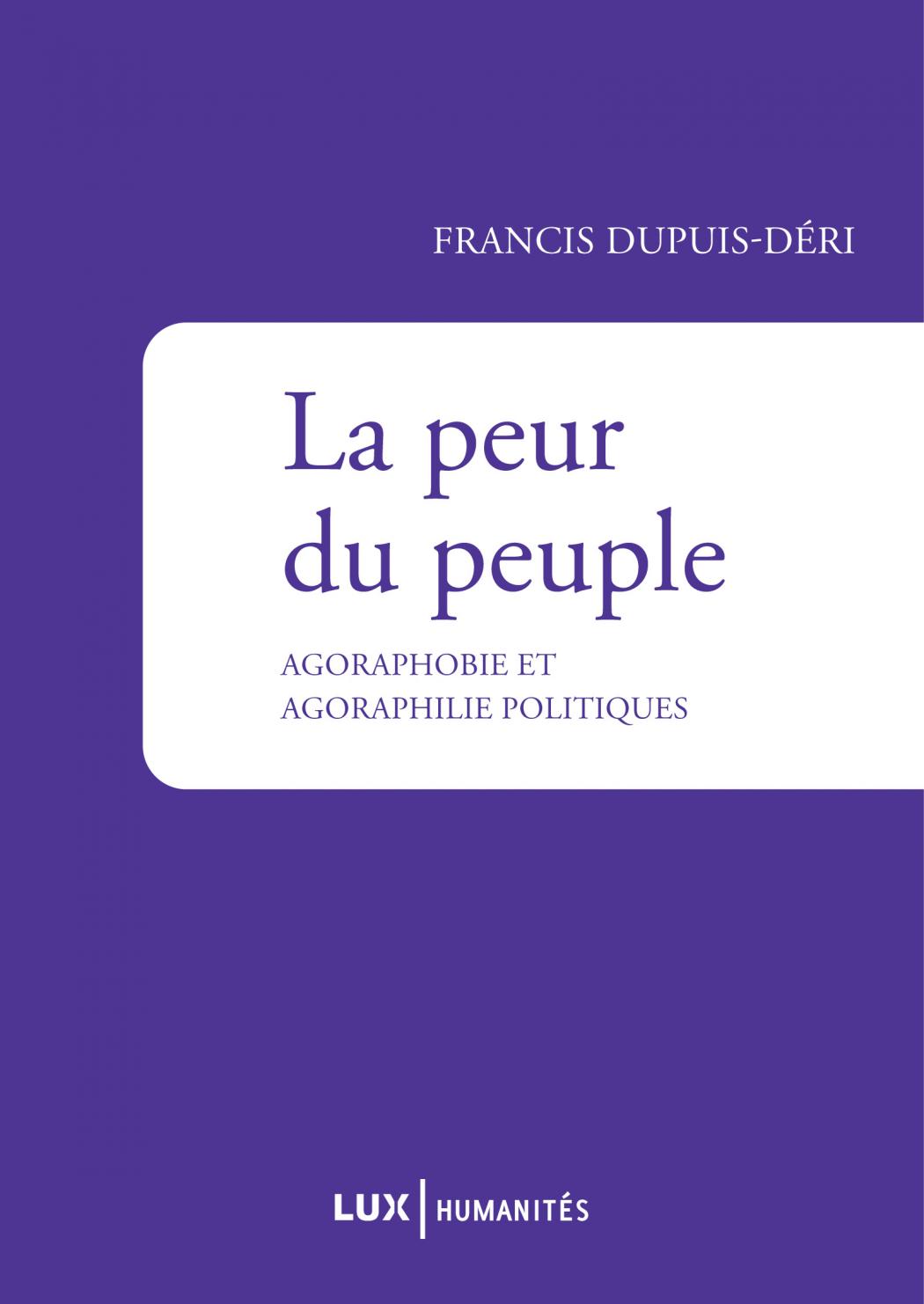
ENTRETIEN AVEC FRANCIS DUPUIS-DÉRI
La peur du peuple, est le prochain ouvrage signé par le politologue Francis Dupuis-Déri. Cette fois-ci, le chercheur se penche sur l'opposition entre les agoraphobes (pourfendeurs de la démocratie directe) et les agoraphiles (défenseurs de la démocratie directe). L'Esprit libre s'est entretenu avec lui afin d'en savoir plus sur cet ouvrage qui plonge au cœur du débat entre démocratie directe et démocratie représentative.
Q. Dans votre livre Démocratie. Histoire politique d'un mot, vous vous êtes intéressé au glissement de sens associé au mot démocratie. Ainsi, à partir d'une conception directe et populaire de la démocratie, les élites en sont venues à imposer un nouveau sens à ce mot: démocratie est aujourd'hui synonyme de régime électoral. Peut-on établir une continuité entre cet ouvrage et La peur du peuple ?
R. Oui, effectivement, la lecture de textes du XVIIe siècle — discours, manifestes, journaux, lettres personnelles, etc. — m'avait fait comprendre que ceux que l'on nomme les «pères fondateurs» des soi-disant «démocraties» modernes, en particulier aux États-Unis et en France, étaient ouvertement antidémocrates, c'est-à-dire qu'ils ne se réclamaient pas de la démocratie, et qu'ils utilisaient le mot «démocratie» comme un repoussoir, un épouvantail. Les «démocrates», ce sont les «autres», les irresponsables qui prônent le chaos, la tyrannie des pauvres, etc. Mais vers 1830-1850, l'élite politique va s'approprier le label «démocrate» à des fins électorales, constatant que ce label attire des suffrages des classes populaires. En un temps très court, tous les candidats vont prétendre être pour la démocratie (un phénomène d'ailleurs discuté par les journaux de l'époque). Mais ce que désigne le mot a changé, en deux générations : les pères fondateurs entendaient par «démocratie» un régime où le peuple se gouverne directement, par des assemblées populaires et délibératives; or maintenant, le terme désigne le régime électoral. Exit, donc, la «démocratie directe», et vive la «démocratie représentative».
Considérant ce changement de signification, à la fois descriptive (ce que le mot désigne) et normative (la démocratie c'est le mal, puis finalement le bien), je ne parvenais pas moi-même à utiliser de manière satisfaisante des notions telles que «antidémocrate» pour désigner une position politique précise. En effet, ce mot pouvait désigner parfois des opposants à la démocratie «directe», d'autres fois des opposants au régime électoral. C'est donc par souci de précision que j'ai eu à ce moment l'idée d'emprunter à la psychologie la notion d'«agoraphobie», pour désigner spécifiquement la peur du peuple assemblé pour délibérer et se gouverner, donc la peur de la démocratie directe. Puis j'ai avancé dans ma réflexion, et j'ai aussi proposé le terme «agoraphilie», pour désigner les partisans de la démocratie directe. Si j'ai brièvement présenté ces deux nouveaux concepts dans le premier livre, ce nouvel ouvrage est entièrement consacré à discuter de cette opposition entre agoraphobie et agoraphilie, autant en philosophie politique que dans les luttes sociales.
Q. Dans l'invitation au lancement de votre livre, il est dit que vous avez une « très bonne connaissance des expériences de la démocratie directe, y compris hors de l'Occident ». Quelle place prendront les exemples non-occidentaux dans votre ouvrage et peut-on toujours parler de démocratie si les pratiques en question ne sont pas senties comme telles par les peuples qui les portent ?
R. La pratique qui consiste à s'assembler dans une agora formelle ou non, pour délibérer au sujet des affaires communes et prendre des décisions collectivement, semble aussi ancienne que l'humanité. On la retrouve à peu près partout, y compris dans des contextes où règnent des gouvernements par ailleurs très autoritaires (en Chine, par exemple, ou au Moyen Âge en Europe). Dans mon ouvrage, je rappelle, par exemple, que les colonisateurs qui arrivaient en Nouvelle France constataient que les Autochtones pratiquaient ce mode d'autogouvernement, et qu'il y avait des assemblées d'anciens, de femmes et de l'ensemble du village. Je discute aussi de l'expérience des assemblées en pays Kabyle, des assemblées non-mixtes de femmes chez le peuple Igbo au Nigéria, ou encore de l'expérience plus récente des Zapatistes au Mexique. Tous ces exemples sont très inspirants pour réfléchir à la manière dont s'articule aujourd'hui le conflit entre la pensée de l'agoraphobie politique et celle de l'agoraphilie politique. Ainsi, l'agoraphobie politique affirme qu'en Occident aujourd'hui, la démocratie directe est tout simplement impossible à mettre en place, pour des raisons d'excroissance démographique, de complexification des sociétés et d'un individualisme trop développé. Nous serions donc, en Occident, à la fois les représentants de la civilisation qui se considère comme la plus évoluée de tous les temps, mais aussi des individus incapables de s'autogouverner, alors que des peuples considérés comme «primitifs» en ont été capables pendant des siècles, voire des millénaires. La question n'est donc pas de savoir si ces peuples s'identifiaient à des notions comme «démocratie» ou «anarchie», mais de réfléchir aux débats qui nous préoccupent ici et maintenant, en nous inspirant d'expériences humaines qui ne sont pas uniquement celles de l'Occident, ou de manière encore plus restrictives celles des États-Unis et de la France (les deux pays les plus souvent pris comme exemple, lors des discussions au sujet de la démocratie). Cela dit, je mobilise aussi des exemples inspirant pour l'agoraphilie et tirés de l'histoire occidentale, comme les conseils ouvriers ou des collectifs féministes.
Q. Votre livre plonge au cœur d'un débat qui en intéresse plusieurs. Qu'est-ce que peut apporter la lecture de votre à livre à une personne qui cherche à faire vivre la démocratie directe au jour le jour dans ses implications politiques ou dans son milieu de travail par exemple ?
R. Je ne sais pas, il faudrait lui demander… Mais ce que j'espère, c'est qu'il est possible d'y trouver des outils pour mieux saisir la logique des arguments contre la démocratie directe (c'est inefficace, c'est trop long, etc.), et d'y répondre par des contre-arguments crédibles, d'un point de vue philosophique, historique et politique. C'est sans doute d'autant plus nécessaire, selon moi, que l'agoraphobie fleurit aussi bien chez les réactionnaires et les conservateurs que chez les progressistes et même les révolutionnaires (je discute d'exemples d'agoraphobes de gauche dans l'ouvrage : Lénine, évidemment, mais aussi les philosophes Chantal Mouffe et Frédéric Lordon, entre autres). Les arguments de l'agoraphobie politique peuvent se résumer, pour faire bref, à l'idée que les individus qui s'assemblent pour délibérer sont irrationnels, et donc des proies faciles pour les démagogues qui les encouragent à prendre de mauvaises décisions, sans compter que l'agora est un lieu dominé par des conflits entre des cliques qui cherchent à en prendre le contrôle. L'agoraphilie politique, pour sa part, renverse ces arguments en rappelant que les individus qui veulent nous gouverner pour notre bien sont également irrationnels (passion pour le pouvoir, pour les honneurs et la gloire, etc.), pratiquent la démagogie et constituent une élite qui a des intérêts contraires au reste du peuple (dès qu'il y a une distinction entre gouvernants et gouvernés, il y a une inégalité politique et des intérêts contradictoires). De plus, l'agoraphilie politique peut rappeler des exemples historiques et contemporains pour démontrer que le peuple assemblé sait bien se doter de rituels et procédures pour faciliter le plus possible un bon processus de prise de décision. Évidemment, il n'est pas question de prétendre que la démocratie directe est un régime parfait (l'être humain étant imparfait, il ne peut donc y avoir de régime politique parfait), mais plutôt d'admettre que c'est le seul régime dans lequel le peuple est politiquement libre, puisqu'il n'est pas gouverné.
Q. Un des objectifs de votre nouveau livre est d'exposer le rapport délicat entre « le peuple assemblé à l'agora pour délibérer (le dêmos) et celui qui descend dans la rue pour manifester, voire pour s'insurger (la plèbe) ». Lors de la grève étudiante de 2012, les liens entre dêmos et plèbe ou entre l'assemblée générale et la rue étaient clairs pour les étudiante.es et une certaine partie de la population, mais beaucoup moins pour le gouvernement et les élites. Est-ce que c'est ce genre de rapports qui vous intéresse dans La peur du peuple et comment les traitez-vous ?
R. Oui, tout à fait : je présente de nombreux exemples d'expressions de l'agoraphobie politique dans des déclarations publiques à l'occasion du Printemps érable, mais aussi d'Occupy et de Nuit debout, entre autres. Un fait intéressant : en 2012, les médias étaient saturés de critiques contre la «démocratie étudiante» et les assemblées générales, présentées comme des lieux chaotiques contrôlés par une clique manipulatrice d'anarcho-syndicalistes… Or, curieusement, je n'ai trouvé aucune critique adressée à des assemblées qui ont voté contre la grève; on ne critiquait que les assemblées qui votaient pour la grève. Est-ce donc, alors, la démocratie directe qui est problématique, ou plutôt le choix que prennent certaines assemblées? Mais si c'est le choix (de faire la grève), pourquoi alors critiquer la démocratie directe elle-même ? C'est ce type d'incohérence que je tente d'identifier dans les discours de l'agoraphobie politique.
Quant au lien entre s'assembler pour délibérer et s'assembler pour manifester, il n'est pas pure illusion. Dans l'histoire, l'amalgame est souvent présent dans les discours de l'agoraphobie politique, comme on peut le constater au sujet des interdictions pour les esclaves de s'assembler dans les colonies britanniques, ou dans les règlements municipaux contre les attroupements illégaux, ou encore dans les propos à l'égard de Nuit Debout, à Paris au printemps 2016 : non seulement les «nuitdeboutistes» étaient présentés comme de doux rêveurs assemblés Place de la République pour le simple plaisir insignifiant de parler, parler, parler, mais on leur reprochait aussi d'accueillir des «casseurs» qui se lançaient à l'assaut de la ville. Or, j'ai essayé de comprendre en quoi il y a réellement un lien entre la pratique de l'assemblée et celle de la manifestation ou de l'émeute (même si, évidemment, toute émeute n'est pas précédée d'une assemblée délibérante). J'ai essayé aussi de complexifier l'analyse, en étudiant dans un premier temps comment l'agoraphilie politique (l'amour du peuple assemblé) est traversée par une tension entre une tendance plutôt «assembléiste» et une tendance «insurrectionnaliste», puis, dans un second temps, comment des pratiques insurrectionnelles interviennent en assemblée (par exemple, des lesbiennes perturbant des assemblées féministes pour dénoncer la lesbophobie ambiante), et comment il est possible de s'assembler et délibérer en manifestation, voire en émeute. J'ai aussi rappelé que lors d'insurrections, le peuple très souvent se dote d'espace délibératif (par exemple lors de la Révolution française de 1789, en Espagne en 1936, en Hongrie en 1956, en Argentine au début des années 2000, etc.).
Q. Dans la description de l'ouvrage, il est dit que celui-ci se situe « à la croisée des chemins entre la philosophie politique, l'anthropologie et la sociologie ». Pensez-vous que le temps des champs disciplinaires est révolu ? Comment une pluralité d'approches intellectuelles vous permet-elle de mieux cerner votre objet sans perdre de vue vos objectifs ?
R. Il s'agit d'une démarche personnelle, mais qui — je l'espère — est stimulante : le travail de théorisation et de conceptualisation de la philosophie politique est d'autant plus fructueux (c'est mon pari) s'il s'inspire de la réalité anthropologique, historique et sociale. J'articule donc ma réflexion en m'inspirant de « grands » philosophes, mais en discutant leurs thèses à la lumière de la réalité sociopolitique. Cela dit, mon approche m'amène aussi à considérer que la philosophie s'incarne et s'exprime dans les pratiques sociopolitiques, ainsi que dans les discours de « simples » individus. C'est une manière de suggérer que le débat entre l'agoraphobie et l'agoraphilie politiques porte aussi sur cette question essentielle : à qui appartient la pensée politique, qui la « produit » et pourquoi ? Le « premier » agoraphobe était Socrate (médiatisé par Platon), qui jugeait que le dêmos était une bête irrationnelle et dangereuse, incapable de saisir le Vrai (il semble d'ailleurs que ni Socrate, ni Platon, ne daignaient participer à l'assemblée citoyenne)… Or l'agoraphilie est, par définition, contre l'idée de « philosophes-rois » qui détiendraient le monopole du pouvoir aussi bien en politique qu'en philosophie.
Francis Dupuis-Déri est professeur au Département de science politique de l'Université du Québec à Montréal et chercheur à l'Institut de recherches et d'études féministes. La peur du peuple sera disponible en librairie dès le 27 septembre 2016.


Ajouter un commentaire